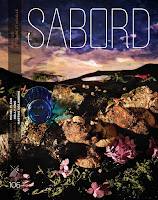Depuis longtemps, le mouvement perpétuel me fascine.
Du mythique Juif errant aux bateaux fantômes qui dérivent des années
durant en haute mer, jusqu’aux corps célestes qui gravitent sans relâche
dans l’espace, l’idée du déplacement incessant est séduisante. Et aussi
humaine, tellement humaine, comme le rappelle Sylvie Lainé dans son magnifique recueil Fidèle à ton pas balancé :
« Nous sommes une espèce vivante, et tout ce qui est vivant avance et
marche, et bouge et se transforme. Ce qui ne bouge plus est mort. »
Auteure de nouvelles peu nombreuses (une quarantaine de fictions
brèves), mais toujours remarquées, l’écrivaine a rassemblé dans Fidèle à ton pas balancé la
quasi-totalité de sa production littéraire. De belle facture, l’ouvrage
séparé en sept sections convie à une plongée nécessaire dans
l’altérité, « en équilibre vertigineux au bord de la fêlure ». Car les
relations affectives, chez Lainé, témoignent souvent d’un accord
complexe, protéiforme, à la manière du lierre qui meurt s’il ne peut
s’attacher.
Il en résulte une affection indéniable pour l’humain, entremêlée du souhait de comprendre ses faux pas, ses travers. L’égoïsme y prend notamment des proportions cruelles dans « Les yeux d’Elsa ». Charlie Ming, « recruteur » de dauphins améliorés pour les chantiers, s’entiche de l’une de ses prises, Elsa, un cétacé aux yeux sublimes pourvu d’une IA (intelligence artificielle) surdéveloppée pour un mammifère marin. Après l’avoir soignée, Charlie convient avec Elsa de la revoir une fois tous les quinze jours, lors des congés de son amante au chantier. Mais cet arrangement n’honore que l’amour-propre du recruteur, en plus de bafouer la liberté de sa partenaire, faisant de ce partage un acteunilatéral. Et pourtant…
Il en résulte une affection indéniable pour l’humain, entremêlée du souhait de comprendre ses faux pas, ses travers. L’égoïsme y prend notamment des proportions cruelles dans « Les yeux d’Elsa ». Charlie Ming, « recruteur » de dauphins améliorés pour les chantiers, s’entiche de l’une de ses prises, Elsa, un cétacé aux yeux sublimes pourvu d’une IA (intelligence artificielle) surdéveloppée pour un mammifère marin. Après l’avoir soignée, Charlie convient avec Elsa de la revoir une fois tous les quinze jours, lors des congés de son amante au chantier. Mais cet arrangement n’honore que l’amour-propre du recruteur, en plus de bafouer la liberté de sa partenaire, faisant de ce partage un acteunilatéral. Et pourtant…
Cette alliance absolue paraît un temps possible à So-Ann, dans la
majestueuse nouvelle « L’opéra de Shaya ». La planète sur laquelle
s’installe So-Ann doit en effet constamment se réinventer pour survivre.
D’emblée, cet environnement semble idéal pour la nomade qu’est So-Ann :
« Une planète qui t’accepterait juste pour le partage. Une planète qui
pourrait s’adapter sans se renier. » Mais les termes de « l’entente »
surprendront la jeune femme, dont l’une des tâches principales est de
donner son ADN à la faune et à la flore environnantes, afin qu’elles
l’intègrent et se transforment de plus belle. So-Ann rechercherait-elle
davantage de stabilité qu’elle le croit, aurait-elle vu en Nico, jeune
homme imprégné par le voyageur précédent, une façon de trouver
sa cadence propre, son harmonie intérieure? La végétation vibrante de
Shaya rappellerait-elle la symbiose du lichen, qui ne peut croître sans
la cohabitation, l’immersion jusqu’à la fusion dans l’autre?
C’est du moins ce qu’illustre la superbe nouvelle « Un amour de
Sable », dans laquelle des géologues et une biologiste analysent les
échantillons de dunes colorées. Sur cette planète à première vue
inhabitée, le sable, curieux de l’échange avec les nouveaux venus,
possède une conscience singulière. Tandis que les scientifiques évaluent
ses composantes et lui permettent, par accident, de découvrir l’ADN
humain, la créature sablonneuse se fait la réflexion que « l’immersion
dans le partenaire éta[it], en soi, une forme de partage vraiment
révolutionnaire ».
Encore une fois, Sylvie Lainé rend compte de la portée de sa
science-fiction, qui culmine dans ces vingt-six nouvelles, toutes
mémorables. Écrivaine trop rare, l’auteure célèbre le bouleversant
équilibre entre la science et l’humain. Fidèle à ton pas balancé
consacre cette approche indispensable du genre en une envolée lucide
quant à ce que nous sommes réellement, tout en « laiss[ant] glisser, [un
temps…], [notre] vieux manteau d’humanité… ».
Ce manteau élimé d’humanité, les protagonistes de Station Eleven
le portent sur leurs frêles épaules, dans un monde en reconstruction.
Essentiellement auteure de romans policiers, Emily St. John Mandel
propose dans son quatrième livre un récit post-apocalyptique narrant
simultanément l’éclosion de la grippe géorgienne, qui décime 99 % de la
population, ainsi que les efforts des survivants pour s’adapter vingt
ans plus tard. À l’instar de Sylvie Lainé, Emily St. John Mandel met au
premier plan les relations humaines et le besoin de l’autre. Station Eleven,
dont le titre renvoie à une bande dessinée de science-fiction, est par
conséquent un roman sans véritable héros, sinon la tendresse d’une
communauté au sens large.
Le mouvement incessant est également à l’honneur par le biais de la
Symphonie itinérante, un groupe d’acteurs et de musiciens nomades, dont
Kirsten fait partie. Kirsten avait 8 ans lorsque la grippe a cloué à
jamais les avions au sol et qu’ont agonisé les ultimes éclats des
lampadaires. Elle a ainsi connu « le dernier mois de l’époque où il
était possible, en appuyant sur les touches d’un téléphone, de parler
avec une personne qui se trouvait à l’autre extrémité du globe ». La
jeune femme a trouvé auprès de la Symphonie itinérante une famille
adoptive, même si le monde de l’An vingt est fréquemment barbare, comme
en témoignent les disparitions de membres de la troupe, l’obscurantisme
religieux et les tatouages rituels en forme de couteaux qu’arborent les
survivants. Mais, en rendant hommage par-delà les décennies à
Shakespeare ou en entretenant un musée dans l’aéroport abandonné de
Severn City, les habitants de l’An vingt honorent la mémoire des siècles
passés. Siècles dont les souvenirs s’amenuisent, comme le lichen
s’effrite sous les bottes des marcheurs au long cours.
Le talent d’Emily St. John Mandel, outre son écriture précise et
évocatrice, réside dans les touches typiquement humaines qui
caractérisent ses personnages, tout en contrastes. De plus, l’auteure
cisèle des images inoubliables, tel cet avion en quarantaine à
l’aéroport, sarcophage scellé à jamais sur ses passagers emmurés
vivants. Les retrouvailles avec l’humanité seront émouvantes ou ne
seront pas, à l’instar de cet échange entre les habitants de l’aéroport
et un nouvel arrivant :
« — J’étais à l’hôtel. […] J’ai suivi vos empreintes dans la neige.
Des larmes coulaient sur ses joues.
— D’accord, […] mais pourquoi pleurez-vous?
— Je croyais être le seul survivant. »
Des larmes coulaient sur ses joues.
— D’accord, […] mais pourquoi pleurez-vous?
— Je croyais être le seul survivant. »
Nul doute, la phrase peinte sur la caravane de tête de la Symphonie
itinérante est plus que prophétique. Et l’humain, comme le lierre, peut
s’attacher à comprendre l’altérité.
Parce que survivre ne suffit pas.